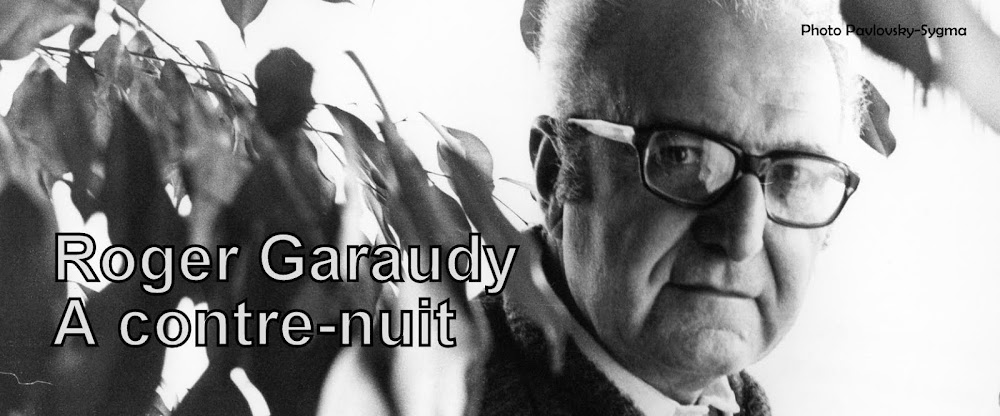L'amour
 |
| Henri Matisse. Le rêve. 1935 |
La
deuxième expérience, et la plus décisive, est en effet celle de
l'amour, parce qu'elle est la première brèche dans le monde des
choses dans lequel nous enferment les postulats du positivisme: nous ne sommes pas entourés que d'objets, d'une nature
inerte, dont nous aurions seulement à devenir « maîtres et
possesseurs » comme le voulait Descartes. Dans ce qui nous entoure
il y des visages, et, derrière eux, ce qui n'est pas seulement un
objet, un « non-moi », mais des sujets. Un visage n'est
pas seulement une image mais un signe. Un signe qui
désigne,
au-delà de ce qui est perçu, une présence et son sens : du défi
ou de l'humilité, de la colère ou de l'amour.
Le moi,
comme l'écrivait Martin Buber, rencontre un « tu ».
Ce
n'est pas une chose que je peux saisir par un concept, ce
n'est
pas un instrument ou un obstacle.
Dans le
monde décrit par Hobbes, « l'homme est un loup
pour
l'homme ». Il en est généralement ainsi dans un monde
obéissant
à la seule logique du marché, qui, par sa concurrence
est une
logique de jungle : une logique de guerre, de guerre
de tous
contre tous, « l'autre » ne pouvant être qu'un concurrent,
un
rival, un obstacle, ou bien un moyen de ma propre
promotion.
L'individualisme,
où chaque « moi » est enfermé dans son
sac de
peau, comme un atome séparé de tous les autres par un
vide,
est le produit d'une époque historique. L'opposant à la
personne,
dans son rapport avec l'autre et le tout autre ; Péguy
disait
: « L'individu, c'est le bourgeois que tout homme porte
en lui.
»
Dans
cette conception à la fois insulaire et agressive, la liberté
de
chacun, confondue avec sa propriété, est cadastrée comme
elle.
Ma liberté s'arrête alors où commence la liberté d'autrui,
comme
une propriété est bornée par la propriété des autres propriétaires.
Mais la
liberté des autres n'est pas la limite de ma
liberté.
Elle en est la condition.
Au-delà
de cette période historique, caractéristique d'une
société
marchande, et même à l'intérieur d'une telle société,
des
hommes et des femmes n'en acceptent pas les cloisonnements
et les
affrontements. L'autre n'est pas un moyen de plaisir
ou de
service. Non pas un obstacle, mais une ouverture
permettant
le passage de l'individu à la personne, de l'être à
la
relation, de l'insularité à la fécondation réciproque.
Et cela
s'appelle l'amour.
La
sortie de soi, fondamentale et première.
L'homme
n'est pas né Robinson. Il a un père et une mère.
Il vit
dans une communauté, en osmose avec elle. L'idée d'un
moi
individuel suffisant à lui-même est une abstraction.
La
personne ne peut émerger du monde animal que lorsque
cette
solidarité de la communauté ne se réduit plus aux fonctions
de
chaque membre comme dans la ruche, la termitière
ou la
horde, consacrées à la subsistance, à la défense et à la propagation
de
l'espèce.
La vie
proprement humaine commence lorsque les fins de la
société
ne sont plus inscrites d'avance dans les instincts.
Avec la
conscience et le choix des fins, ce n'est pas seulement
le
travail qui devient un travail humain, c'est-à-dire précédé par
la
conscience de son but.
L'homme
est l'animal qui fait des outils et des tombes.
Les
outils témoignent du détour de la création de moyens
pour
atteindre une fin. Cela s'appelle la conscience, et plus tard
la
science.
Les
tombes attestent que l'homme ne laisse plus ses morts
réintégrer
le cycle des métamorphoses de la vie simplement
naturelle.
Il considère sa vie comme distincte de la simple
nature
puiqu'elle implique le sacrifice. Même si nous en ignorons
les
rites et les intentions, il y a là les traces d'un travail
qui
n'est plus directement utilitaire.
L'outil
et le sacrifice sont les deux premiers témoins de communautés
spécifiquement
humaines.
De
l'outil il a été beaucoup parlé, au point que l'on a cru,
en
Occident, pouvoir définir et hiérarchiser la civilisation
humaine
à partir de ce seul critère : âge de la pierre taillée, de
la
pierre polie, du bronze, du fer, et, plus tard, de la vapeur,
de
l'électricité, de l'atome...
Du
sacrifice et de son histoire, en Occident, il a été fait moins
de cas
bien que de lui soient nées non seulement les questions
que se
posait l'homme sur le sens de sa vie, à travers les religions,
les
arts, et plus simplement les rapports proprement
humains
de communauté. A l'inverse de l'individualisme occidental,
celui
des Grecs, comme celui qui règne de la Renaissance
à nos
jours, celui qui fait de l'individu le centre et la
mesure
de toutes choses, la communauté est une forme de rapports
humains
où chacun se sent responsable de l'action de tous
les
autres.
Le
travail est le principe de nos rapports avec la nature.
Le
sacrifice celui de nos rapports avec les autres.
L'amour,
sous sa forme proprement humaine en est la forme
première.
La
sexualité, lorsqu'elle n'est pas exclusivement l'instinct de
propagation
de l'espèce, comme dans le monde animal, est une
première
sortie du « petit moi ».
Eprouver
le besoin de l'autre, c'est prendre conscience que
je ne
me suffis pas à moi-même. Je ne suis plus à moi-même
ma
propre fin. Je suis un être inachevé qui ne peut s'accomplir
que par
la complémentarité de l'autre, d'une femme pour
un
homme, d'un homme pour une femme.
Besoin
conscient car la conscience proprement humaine est
d'abord
celle de cet inachèvement par lequel, à la différence
de tout
animal, l'homme éprouve comme une question le sentiment
de ce
qui lui manque pour devenir pleinement humain.
De
cette question émerge le problème du sens. Il ne se pose
que
lorsque déjà l'homme a conscience de n'avoir plus en luimême
son
centre. Mon centre n'est plus mon moi. Il est dans
l'autre.
Dans cet autre que, par l'amour, je porte en moi. Perte
du «
moi » fondé sur l'illusion d'être unique. Retour au « soi »
enrichi
de la présence de l'autre. Où nous ne faisons ni deux,
ni un
(comme le disent, en leur langage, Vadvaïta védantin ou
la
trinité chrétienne).
Etre un
et deux, comme les pôles indissociables de
l'«
aimant ».
Le
sacrifice est aussi ce qu'il y a de proprement humain dans
l'amour
: préférer le plaisir de l'autre au sien propre, la joie
de
l'autre à la sienne, la vie de l'autre à la sienne. Telle est
dans
l'acte d'amour l'expérience de base de la transcendance,
qui est
le contraire de la « suffisance » : le « moi » dans
l'illusoire
solitude de sa « suffisance » met en cause ses propres
fins en
ordonnant sa propre vie à l'autre comme une fin
nouvelle.
«Je
pense, donc je suis. » Tant d'inhumanité en si peu de
mots !
Comme si je n'existais pas avant de penser et comme si
cette
pensée n'était pas habitée par l'histoire et la culture des
générations
antérieures.
« Nous
aimons, donc nous sommes. » « En toi, je suis. » Loi
première
de toute vie proprement humaine.
Une
nouvelle naissance, une nouvelle création, car la totalité
nouvelle
que nous formons par l'amour est quelque chose
d'autre
et de plus que l'addition des forces de chacun.
L'émergence
de ce radicalement nouveau que l'on ne peut
«
déduire » à partir de chacun des éléments, mais seulement
produire
par leur rencontre, est une forme plus haute encore
de
l'expérience de la transcendance et qui naît de la première
sortie
de moi dans l'amour. La première ébauche de la transcendance
était
le dépassement de ses propres frontières. La
seconde
est celle de l'émergence de ce qui est radicalement nouveau
et ne
peut se réduire à la somme ou à l'addition des
parties.
Le
surgissement de cette présence à laquelle on ne peut assigner
un mot
ni un concept est, pour la raison simplement
déductive,
un mystère sinon un scandale.
Elle a
pourtant sa source dans l'amour, cette polarité spécifiquement
humaine
du sexe et du sacrifice.
Cette
unité, racine de l'humain, doit être préservée contre
tout
dualisme : ni sexualité sans amour, ni défiance du sexe.
La
sexualité sans amour est un produit de l'individualisme
mutilant
pour lequel tout ce qui n'est pas « moi » est un moyen
de ma
jouissance et de mon pouvoir.
Cet
usage de la sexualité est comparable à celui de la drogue
comme
jouissance solitaire et puissance illusoire. La forme
actuelle
de la publicité pour les préservatifs illustre cette dégradation.
Le
préservatif n'y est plus présenté comme l'un des moyens
de ne
plus laisser la naissance au hasard, forme de la maîtrise
sur la
nature, faisant de la procréation un acte volontaire, un
acte de
culture. Mais il est présenté comme un produit de la
peur,
notamment du sida, et comme un moyen de garantir la
sécurité
de rencontres occasionnelles en allant à la discothèque
pour y
échanger deux plaisirs solitaires, sans amour et sans lendemains.
Comme
si le « jeu » sexuel était, pour oublier le non-sens
quotidien
de la vie, un dopage désespéré, de même que l'excès
de
l'alcool ou des décibels.
Curieusement
les interdits prétendument « religieux » partent
d'une
même conception de la sexualité : du même séparatisme
de la
matière.
Pourtant,
dans les Évangiles (Mt 12, 3-9; Me 10, 2-12;
Le 16,
18) lorsqu'est abordé le problème du mariage, sous
l'aspect
d'ailleurs étriqué de la casuistique des pharisiens sur
la
répudiation, Jésus échappe à leur piège en rappelant seulement
que
dans la Genèse (1, 27) l'homme complet est celui
du
couple : homme et femme il les créa, et ils ne furent qu'une
seule
chair. Le formalisme de la Loi, en matière de « répudiation»
ignore, dans sa définition de l'adultère, le rapport proprement
ignore, dans sa définition de l'adultère, le rapport proprement
humain
du mariage. A aucun moment Jésus, dans les
Evangiles,
n'invoque la fécondation comme finalité du mariage,
ni
n'exprime la moindre méfiance à l'égard de la sexualité.
Une
longue tradition catholique, remontant à saint Paul et
à sa
conception de la femme, a si longtemps enseigné le
contraire,
que le concile de Vatican II a dû rappeler que « le
mariage
n'est pas institué en vue de la seule procréation » (Gaudium
et
Spes, 2, § 50, 3).
Cette
sorte de biologie théologique (comme disait à ce sujet
le père
Teilhard de Chardin) a conduit à des résultats inverses
de ceux
qu'on lui assignait : saint Paul a montré que comme
contrainte
extérieure « la loi produit la colère » (Rm 4, 15) et,
même
s'il la considère comme « sainte » (7, 3) lorsqu'elle
s'exerce
comme « commandement », elle conduit à « la virulence
du
péché » (idem) et elle divise l'homme, « la loi est spirituelle
et moi
je suis charnel » (7, 14). Ne pouvant appliquer
cette
loi parce que le péché l'habite, il est acculé au dualisme,
au
séparatisme de la matière : « Qui me délivrera de ce corps
qui
appartient à la mort ?» (7, 24).
Il
suffit d'inverser ce rapport, à l'intérieur du même dualisme,
pour
entendre le cri de la révolte contre des injonctions
qui ne
peuvent s'appliquer à l'homme entier, esprit et corps.
Qui me
délivrera de ces contraintes qui m'empêchent de vivre ?
La loi
n'est plus alors seulement le « révélateur » du péché, elle
y
conduit, par un angélisme coupant l'homme en deux : l'âme
et le
corps.
Mépriser
le corps ou même le diaboliser, tant que l'Eglise
avait
pouvoir de répression, conduisait à l'hypocrisie de la
« faute
» cachée. Lorsqu'elle a perdu ce pouvoir, même sur les
esprits,
la réaction de révolte s'exprime ouvertement, dans la
parole
et dans la pratique. Le corps, à son tour, fait sécession,
et
s'érige en souverain.
La dure
vérité de Nietzsche se manifeste dans le quotidien :
« Le
christianisme a donné du poison à boire à Eros. Il n'est
pas
mort, mais il a dégénéré en vice. »
Tel est
le châtiment de qui n'accueille pas l'homme dans sa
totalité.
Car le sexe ne devient un démon que lorsqu'on en a
fait un
dieu.
Le sexe
n'est pas seulement le médiateur matériel de l'espèce
pour sa
propagation. Dès que l'homme émerge de l'animalité,
par l'outil
et le sacrifice, il n'est plus seulement un fait de
nature,
mais de culture. Le corps est le moyen d'expression de
l'homme,
dans le don et le sacrifice pour transformer l'autre,
se
transformer lui-même, comme dans le travail pour transformer
la
nature.
Le
rapport d'amour entre l'homme et la femme fait échapper
à la
mort. Pas seulement parce qu'il perpétue la vie naturelle
de
l'espèce, mais parce qu'il arrache l'individu qui naît
et
meurt à son artificielle solitude. Il le fait entrer en participation
avec
une réalité humaine qui le dépasse et ne meurt pas :
la
communauté culturelle proprement humaine, celle du sacrifice.
L'égoïste
ou l'avare s'en excluent ; l'homme et la femme
en sont
exclus par un système social réduisant l'homme à n'être
que
producteur et consommateur, c'est-à-dire le réduisant au
seul
rapport avec la nature par le travail et le besoin, et excluant
ses
dimensions proprement humaines (qu'en un autre langage
on
appelle divines et transcendantes) précisément parce qu'elles
brisent
le cercle du besoin et du travail.
Celui
qui n'aime pas demeure dans la mort. Cet amour entre
l'homme
et la femme, cette première sortie du « moi » par le
désir
de l'autre, crée une réciprocité et une forme nouvelle
d'échange
qui n'est plus l'échange fonctionnel et totalitaire,
mais
échange du don et du sacrifice par quoi l'homme devient
humain.
Roger
Garaudy
Avons-nous besoin de Dieu ?
DDB
Avons-nous besoin de Dieu ?
DDB