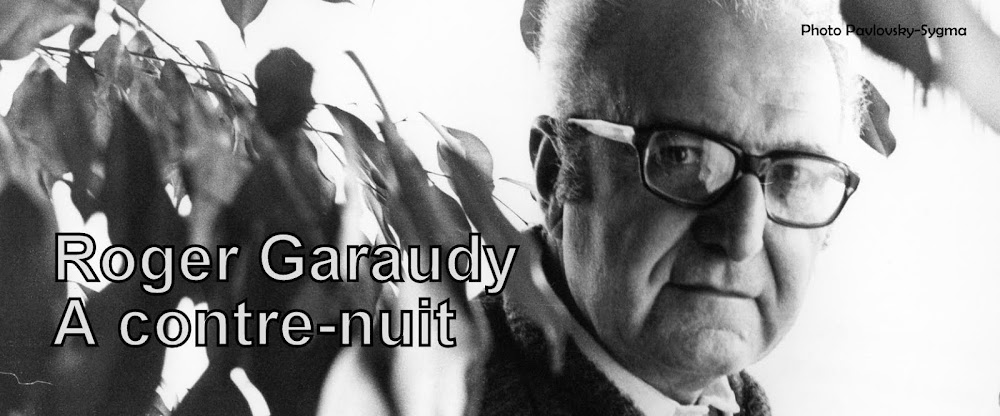|
| Acheter le livre |
« Nouvelle
évangélisation » et « application de la shari'a»
Dialogue des religions ou dialogue de la foi ?
Le premier est une controverse entre théologiens ou religieux,
Le premier est une controverse entre théologiens ou religieux,
armés de dogmes et de réponses, et surtout assurés
de détenir
une vérité totale. Il se peut alors que la
discussion soit courtoise,
tolérante, chacun reconnaissant à l'autre le droit à
l'erreur, avec l'indulgence que l'on peut avoir pour
des enfants,
auxquels on accorde avec bienveillance qu'ils
accèdent un jour
à la vérité totale — la nôtre bien sûr —, après
leurs tâtonnements
et leurs premiers pas.
Dans le meilleur des cas chacun verra dans la
religion de
l'autre un moment, provisoire et partiel (toujours
inférieur) de
sa propre vision.
Entre des chrétiens qui se veulent missionnaires, et
des
musulmans — des « ulémas » — (dont le nom même
implique
qu'ils détiennent la science religieuse), les uns et
les autres
se tenant pour des fonctionnaires de l'absolu, il n'y
a point de
dialogue mais polémique (fût-elle souriante),
prosélytisme et
désir de conversion de « l'autre » pour l'annexer à
sa propre
vérité englobante.
Il est vrai qu'en ce domaine, depuis des siècles
(depuis les
Croisades et les séquelles de ses Inquisitions),
depuis cinq siècles
surtout avec la naissance du colonialisme appelant «
évangélisation
» des Indiens l'invasion, la conquête, le massacre
et
le génocide, l'Occident a donné le pire exemple de
l'intégrisme,
c'est-à-dire de la prétention de détenir la vérité
absolue et, par
conséquent, d'avoir non seulement le droit mais le
devoir de
l'imposer à tous.
Une longue continuité dans la domination a créé une
continuité
perverse. Autrefois : une Église, un Dieu, un roi.
Aujourd'hui : une culture, une technique, un ordre
mondial.
Hors de l'Eglise pas de salut. Hors de l'Occident
pas de civilisation.
Et toujours : hors de ma vérité, l'erreur. Toujours
un
peuple élu : hébreu, chrétien, occidental.
Une telle prétention, appuyée par les armes, le
commerce et
les missions, est la mère des autres intégrismes
dans le monde.
Le colonialisme, sous toutes ses formes, niait la
valeur et combattait
l'existence des autres cultures et des autres
religions
tenues pour inférieures sinon barbares.
L'effort pour résister à cette invasion militaire,
marchande
et spirituelle, suscite une négation de la négation.
Cette réflexion est d'autant plus actuelle que l'on
parle beaucoup,
ces temps-ci, de Rome à Saint-Domingue, de «
nouvelle
évangélisation ».
Appeler à une « nouvelle évangélisation » devrait
exiger de
reconnaître les méfaits de l'ancienne. Elle fut de
modèle
colonial.
Elle a exporté, quand elle ne l'a pas imposé par la
force, une
forme de christianisme coulée dans le moule d'une
culture occidentale
qui considérait n'avoir que deux sources :
judéochrétienne
et gréco-romaine.
Cette théologie de l'histoire permit par exemple aux
colons
puritains d'Amérique d'assimiler les Indiens aux
Amalécites et
aux Philistins de l'Ancien Testament, et, en toute
bonne conscience,
de leur faire subir le même sort pour la plus grande
gloire de Dieu.
Une « nouvelle évangélisation », après une
nécessaire autocritique
de l'ancienne, exige autre chose qu'un habillage
folklorique
de la théologie occidentale par les cultures
autochtones
sous le nom d'« inculturation ».
La reconnaissance de l'unité de Dieu et de sa
présence, qui
ne peut se manifester nulle part ailleurs que
partout, implique
d'abord qu'il ne peut y avoir de « peuple élu »,
hébreu ou occidental,
dont la médiation serait préalable et nécessaire
pour rencontrer
Dieu.
En d'autres termes, pour en finir avec
l'ethnocentrisme, il
faut cesser de confondre foi et religion.
Une religion c'est l'expression de la foi à travers
une culture.
La culture étant l'ensemble des rapports qu'un homme
ou une
communauté entretient avec la nature, les autres
hommes, et
le divin.
La culture judéo-chrétienne et gréco-romaine de
l'Occident
n'est pas « l a » culture, c'est une culture
parmi les autres,
comme la culture chinoise, indienne, africaine,
amérindienne,
islamique.
En chacune de ces cultures s'est posé le problème
des fins
dernières de l'homme, c'est-à-dire le problème
religieux.
Cette découverte de la présence divine au coeur de
toutes les
cultures permet seule de dépasser l'illusion et la
prétention que
toute l'humanité doit passer par la culture juive,
grecque et
romaine exportée par les colonisateurs occidentaux
dans le
monde entier.
L'Esprit est en l'homme et en tout être, non comme
leur propriété
ou leur intériorité, mais comme le mouvement qui, à
travers
la multiplicité et la dispersion des êtres, les
oriente vers
l'Un en un cycle sans fin : Tout vient de Dieu et
tout revient
à Lui, dit le Coran (II, 156).
Cette relation d'intériorité réciproque, ce
mouvement circulaire
par lequel passent incessamment l'un dans l'autre,
et
s'impliquent mutuellement, les trois aspects de la
Trinité, les
théologiens chrétiens l'appellent la « périchorèse
».
Elle permet de comprendre qu'une même foi a pu,
s'exprimant
à travers diverses cultures, donner naissance à de
multiples
religions, et que cette multiplicité même est une
richesse
car elle permet, par la fécondation réciproque
d'expériences
« religieuses » différentes, d'approfondir notre
propre foi, de
prendre conscience de sa spécificité : de perdre
seulement l'illusion
que notre religion est la seule vraie parce que nous
ignorons
toutes les autres.
C'est précisément ce que semble ignorer une «
nouvelle évangélisation
» qui ne commence pas par l'autocritique de
l'ancienne, fondée sur le postulat colonial de
l'ethnocentrisme
occidental.
Cette première évangélisation, en Amérique — malgré
les
protestations évangéliques de quelques prêtres
héroïques
comme le père Montesinos, Pedro de Cordoba ou Mgr
Bartolomé
de Las Casas — fut le prétexte et la caution du
génocide
des Indiens.
En Afrique, là encore malgré les scrupules de
quelques religieux
vite marginalisés, la traite des Noirs, avec ses
cent millions
de morts, ne fut nullement entravée par l'Eglise.
Le départ de cargaisons d'esclaves, au Portugal, au
début du
XIXE
siècle était béni
par un évêque, et cela s'appelait « messe
de la liberté » !
Parler aujourd'hui de « nouvelle évangélisation »,
comme à
Saint-Domingue, sans dire d'abord quelles furent les
racines
profondes, colonialistes et racistes, de la première
évangélisation
de l'Amérique et de l'Afrique, et les arracher
définitivement,
c'est continuer à imposer un christianisme qui n'a
pas
su se désolidariser du dogme de la supériorité de
l'homme
blanc, ni du préjugé selon lequel le christianisme
ne pouvait
prendre racine que dans la culture juive et grecque
et dans
l'organisation romaine, comme si les hautes
spiritualités de
l'Inde, de l'Afrique ou de l'Amérindie ne pouvaient
fournir
un terreau aussi riche à la floraison du message de
Jésus.
Une telle conception de « l'évangélisation »
constitue un obstacle
majeur à un véritable dialogue des religions.
Elle trouve un parallèle, dans le Tiers Monde
(qu'elle traite
avec paternalisme comme mineur), dans une conception
archaïque
de la shari'a, de la loi « divine »,
confondue avec les institutions
d'il y a mille ans et présentée comme la seule
expression valable de l'islam, comme la « nouvelle
évangélisation
» confond le message de Jésus avec l'institution
ecclésiastique
romaine constituée par l'empereur Constantin il y a
seize
siècles.
La confusion sur l'expression : « appliquer la shari'a»,
comme l'actuelle conception vaticane de la «
nouvelle évangélisation
» et le Catéchisme de 1992 qui en est le
fondement
idéologique, sont aujourd'hui les deux obstacles
majeurs du
dialogue islamo-chrétien.
Chez les vaincus du colonialisme, la résistance pour
défendre
leur propre identité, leurs cultures, leurs
religions, les
conduisit le plus souvent à se replier sur le passé,
c'est-à-dire
sur ce qui était antérieur à ces dominations
étrangères, comme
s'il n'y avait de choix qu'entre l'imitation de
l'Occident, ou
l'imitation du passé.
Un intégrisme antithétique de celui des vainqueurs les
amena
à confondre leur foi avec les formes
institutionnelles qu'elle
avait revêtues dans le lointain âge d'or de leur
indépendance
et de leur grandeur.
Une illustration saisissante de cette attitude est
aujourd'hui
donnée dans maints pays islamiques par une confusion
redoutable
sur le terme de shari'a.
Récemment encore, dans ce qui constitue le centre
mondial
de l'intégrisme musulman, l'Arabie Saoudite, une
répression
brutale s'est exercée contre des hommes de foi
désireux de créer
un comité de défense des droits de l'homme contre
l'oppression,
sous prétexte qu'une telle initiative ne pouvait
être acceptée
« dans un pays où est appliquée la shari'a».
Le ministre de
l'Intérieur obtint la caution des « ulémas », pour
cette opération
policière.
Que signifie donc : « appliquer la shari'a»
selon les dirigeants
politico-religieux de l'Arabie Saoudite,
du Pakistan, ou de leurs
émules ?
Le mot shari'a n'est employé qu'une fois dans
le Coran (45,
18) et dans trois autres versets apparaissent des
mots de même
racine : le verbe shara'a (42, 13) et le
substantif shir'a (5, 48).
Cela permet une définition précise.
Le Coran rappelle (en 45, 16) que Dieu a donné aux
fils
d'Israël le livre et les commandements, qui leur
permettaient
de concevoir clairement l'ordre (amr), mais
qu'ils ont introduit
le désaccord après que leur eut été donné la science
(Uni). Dieu
jugera (45, 17). Alors apparaît le mot shari'a (45,
18) : « Nous
t'avons placé sur une voie ( shari'atin ) procédant
de l'ordre. »
En quoi consiste cette « voie » (shari'a) ?
C'est ce qui nous
est précisé en 42, 13 : « En matière de religion il
vous a ouver t
une voie (ici c'est le verbe shara'a ) qu'il
avait recommandée à
Noé, celle-là même que nous t'avons révélée, celle
que nous
avons recommandée à Abraham, à Moïse, à Jésus :
suivez-la,
et n'en faites pas un objet de division. »
Il est donc parfaitement clair :
1 ° que cette voie est celle de Dieu ;
2° qu'elle est commune à tous les peuples, à
qui Dieu a
envoyé ses prophètes (à tous les peuples et dans la
langue de
chacun d'eux).
Or les codes juridiques concernant par exemple le
vol et sa
punition, le statut de la femme, le mariage ou
l'héritage, sont
différents dans la Thora juive, dans les
Evangiles des chrétiens,
ou dans le Coran.
La shari'a (la loi divine pour aller à Dieu)
ne peut donc pas
inclure ces législations (fiqh) qui, à la
différence radicale de la
shari'a commune à toutes les religions,
diffère avec chacune
d'elles selon l'époque et la société où un prophète
a été envoyé
par Dieu.
Dieu dit dans le Coran (13, 38): «A chaque époque un
livre », et encore : « il n'existe pas de communauté
où ne soit
passé un prophète pour l'avertir » (35, 24 et 16,
36).
« Dieu confirme et abroge ce qu'il veut » (13, 39),
ne signifie
évidemment pas qu'il a changé d'avis mais que, par
une « véritable
pédagogie divine », il apporte, au nom des principes
absolus,
une réponse appropriée à la situation historique et
au
niveau de compréhension du peuple auquel il envoie
son messager.
C'est ainsi, par exemple, que la quibla (dont
le sens universel
et dernier est clair : manifester l'unité de la Umma,
tournée vers le même centre pour affirmer l'unité de
Dieu) est
orientée pour un temps vers Jérusalem, puis, pour
des raisons
historiques, tenant aux rapports avec la communauté
juive, vers
La Mecque. A travers ce changement historique le
Coran nous
rappelle la vérité transcendante : Dieu ne
peut être ailleurs que
partout, à l'Orient comme à l'Occident. « L'Orient
et l'Occident
appartiennent à Dieu. Quel que soit le côté vers
lequel
vous vous tournez, la face de Dieu est là » (11,
115).
Les premiers commentateurs du Coran, comme Tabari,
ont
toujours pris grand soin de rappeler dans quel
contexte historique
précis chaque verset est « descendu ».
Cette historicité n'enlève rien à la valeur
universelle et éternelle
de la s h a r i ' a : chaque intervention de
Dieu, dans la communauté
indivisiblement religieuse et politique de Médine,
où
le Prophète est chef d'État, contient un principe
d'action (une
voie religieuse, shari'a) , qui vaut pour
tous les peuples et tous
les temps (comme par exemple : Dieu seul possède,
qui relativise
toute propriété humaine ; Dieu seul commande, qui
relativise
tout pouvoir humain, Allahou Akbar ; Dieu
seul sait,
qui relativise tout savoir humain).
Cette « loi divine », cette shari'a, est
commune à toutes les
révélations et à toutes les sagesses.
Et c'est à partir de cette voie religieuse
immuable que Dieu,
par ses Prophètes, apporte des réponses historiques
correspondant
à la situation particulière de chaque peuple.
L'une des manifestations les plus claires de la
grandeur du
Coran c'est précisément cette articulation de la
transcendance
et de l'histoire, de la religion et de la politique,
en un mot de
la shari'a (qui est parole de Dieu) et du fiqh,
de la législation
(qui est oeuvre humaine).
C'est la différence radicale avec le judaïsme.
Alors que chez Moïse la plus grande place est
occupée par
les commandements, dans le Coran, sur 6 000 versets
200 seulement
portent sur la solution de problèmes de droit.
Mélanger,
sous le nom de shari'a, ce qui est
orientation religieuse et
morale de valeur absolue, éternelle et universelle,
avec les législations
propres à chaque société particulière et à chaque
époque
déterminée, constituerait une judaïsation de l'islam
et nous
conduirait, par le littéralisme, à donner une image
du Coran
radicalement opposée à sa claire définition de la shari'a.
Si l'on ne fait pas cette distinction entre :
— les principes éternels sur les rapports avec D
i e u,
— et les lois particulières par lesquelles les
hommes, à partir
de ces principes, organisent à chaque époque leurs rapports
sociaux, l'on donne une image caricaturale
du Coran.
Par exemple le Coran, qui descend dans une société
où règne
l'esclavage, introduit des règles propres à
l'humaniser.
Est-ce que cet enseignement est devenu caduc parce
que
l'esclavage n'existe plus ? Ou faut-il rétablir
l'esclavage ? Ou
bien devons-nous, comme nous le recommande à chaque
instant
le Coran, « réfléchir » sur les « exemples » qu'il
nous
donne :
« Nous avons proposé aux hommes, dans ce Coran,
toutes
sortes d'exemples, peut-être réfléchiront-ils ? »
(39, 27).
Ainsi seulement un verset comme : « Un esclave
croyant vaut
mieux qu'un homme libre polythéiste » (2, 221), à
condition
de ne pas s'attacher à la lettre, conserve valeur
universelle : la
valeur d'un homme ne dépend pas de son rang ou de sa
fortune,
mais de sa foi et de ses vertus.
Cette distinction entre la shari'a, l'orientation
religieuse et
morale vers Dieu, et les « programmes » ou les «
méthodes »
dont Dieu a laissé à l'homme la responsabilité de
les appliquer
toujours dans les conditions concrètes de leur
société et de leur
temps, est soulignée par le sens du mot shari'a ,
le chemin vers
la source, magnifique façon de dire : le chemin vers
Dieu.
Après avoir rappelé (5, 44 et 5, 46) que les
messages de Moïse
et de la Thora, de Jésus et des Évangiles «
contiennent guidance
et lumière », le Coran ajoute (4, 48) : « Nous avons
donné à
chacun d'eux une voie (shari'a) et un
programme (minhaj). »
A la lumière des deux précédents versets, il est
clair que la
voie, la shari'a a valeur
universelle puisqu'elle est commune en
particulier à tous les gens du Livre; elle
nous désigne les fins
transcendantes, alors que le « programme » ou la «
méthode »
sont les moyens permettant, en chaque moment de
l'histoire,
de faire pénétrer les valeurs transcendantes.
La shari'a est en effet présente et identique
dans les trois
livres révélés :
Le Coran proclame à plusieurs reprises que Dieu
seul possède:
« Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient
« Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient
à Dieu » (2, 116 et 284 ; 3, 109, etc.).
Comme le Deutéronome disait : « A l'Éternel, ton
Dieu,
appartiennent les cieux, la terre, et tout ce
qu'elle renferme »
(10, 14).
Comme l'Évangile, Paul dans I Co 10, 26 : « La terre
et tout
ce qu'elle contient appartient à Dieu. »
Il en est de même, dans les trois Livres, pour « D
i e u seul
commande » et « D i e u seul sait ».
Il est de notre responsabilité de trouver en chaque
moment
les moyens historiques de réaliser ces fins
transcendantes,
comme le Coran nous en donne l'exemple pour la
communauté
de Médine.
Cette claire distinction coranique exclut tout
littéralisme et
nous appelle à réfléchir sur les exemples et non à
donner à des
prescriptions historiques, figurant aussi dans le
Coran, une
application aveugle à tous les temps.
Prétendre appliquer littéralement une disposition
législative
sous prétexte qu'elle est écrite dans le Coran,
c'est confondre
la loi éternelle de Dieu, la shari'a (qui est
un « invariant »
absolu, commun à toutes les religions et'à toutes
les sagesses)
avec la législation destinée au Moyen-Orient au VIP siècle (qui
était une application historique, propre à ces pays
et à cette époque,
de la loi éternelle). Les deux figurent bien entendu
dans
le Coran mais la confusion des deux et leur
application aveugle
— refusant cette « réflexion » à laquelle ne cesse
de nous
appeler le Coran — nous rend incapables de témoigner
du message
vivant, du Coran vivant et éternellement actuel, du
Dieu
vivant.
La loi divine, la shari'a , unit tous les
hommes de foi, alors
que prétendre imposer aux hommes du xxc siècle une législation
du VIIe siècle,
et de l'Arabie, est une oeuvre de division
qui donne une image fausse et repoussante du Coran.
C'est un
crime contre l'islam.
Le Prophète parlant au nom de Dieu tenait
parfaitement
compte de la situation géographique et historique du
peuple
pour lequel il appliquait de manière spécifique les
principes
éternels.
Lorsqu'il ordonne de jeûner de l'aube au crépuscule
(le fil
noir et le fil blanc) il est clair qu'il s'adresse à
un peuple où
le jour et la nuit ont une durée peu différente.
Pour un esquimau,
entre les deux moments, il y a six mois : il faut
donc
« réfléchir ». Comme auparavant pour l'esclavage,
pour ne pas
appliquer littéralement le verset, mais pour nous
interroger sur
le but qu'il visait et l'appliquer dans des
conditions différentes.
Il en est de même pour un bon nombre de versets du
Coran.
Dieu et son Prophète tiennent compte des
circonstances et du
niveau de conscience des peuples auxquels ils
s'adressent pour
que le message pénètre sans vouloir abolir d'un seul
coup
l'ordre existant et en acceptant donc des coutumes,
même si
elles ne répondent pas entièrement aux exigences
absolues de
la shari'a.
Nous avons donc le devoir, à l'égard de chaque
prescription
juridique de nous demander quel était le but visé
lorsqu'elle
a été formulée et les circonstances historiques qui
la rendaient
nécessaire dans un monde où « il y a chaque jour
quelque chose
de nouveau » (55, 28).
La loi ne peut se pétrifier alors que la vie qu'elle
a mission
de façonner dans la voie de Dieu est en perpétuelle
métamorphose.
C'est dans cette perspective historique que l'on
doit, par
exemple, situer la main coupée du voleur, ou la
discrimination
à l'égard des femmes et leur subordination à
l'homme, tradition
de tout le Proche-Orient, comme en témoignent, par
exemple, les épîtres de saint Paul.
Toute lecture des « versets législatifs » doit être
historique.
Par exemple, dans le Coran (IV, 11) la part de la
fille, dans
l'héritage, est la moitié de celle de son frère.
Dans l'Arabie
préislamique la femme n'avait aucun droit sur
l'héritage. C'est
une avancée historique de lui y donner accès. En
outre, dans
la société de l'époque, toutes les charges sociales
incombent à
l'homme. La loi tend à rétablir l'équilibre. Une
application littérale
à nos sociétés serait contraire à l'esprit de
justice qui l'inspirait
au VIIe siècle.
L'essentiel est de ne jamais oublier que le Coran
contient à
la fois la shari'a fondamentale en 5 800
versets et des « exemples
» de son application (en 200 versets) dans un moment
historique
donné, par exemple dans une société esclavagiste.
La pire erreur, mortelle pour l'avenir de l'islam,
serait de
mélanger la loi divine éternelle, la shari'a , avec
ce qui fut le
fiqh (la législation) du VIIE
siècle.
Appliquer la shari'a, c'est le contraire de
cette confusion.
C'est, à partir des principes absolus de la shari'a
(Dieu seul possède,
Dieu seul commande, Dieu seul sait) créer un fiqh
du
XXE
siècle. Et c'est là
une responsabilité commune non seulement
à tous les musulmans, mais, comme le dit le Coran, à
tous les hommes de foi qui ont reçu le message des
Prophètes,
tous envoyés du même Dieu.
Contre ce double obstacle à une véritable rencontre
entre
chrétiens et musulmans : la conception de la curie
romaine sur
la « nouvelle » évangélisation, si proche de
l'ancienne par son
ethocentrisme occidental, et la conception de la shari'a
des intégristes
musulmans voulant immuablement appliquer
aujourd'hui les législations créées pour des
sociétés du VIIE siècle,
que peut être un dialogue de la foi permettant une
fécondation
réciproque ?
Il n'y a de dialogue véritable que lorsque chacun,
au départ,
admet qu'il a quelque chose à apprendre de l'autre,
qu'il est
donc prêt à remettre en cause telle ou telle de ses
certitudes.
C'est pourquoi celui qui s'engage dans cet
authentique dialogue
apparaît parfois comme un dissident en puissance à
l'égard
de sa propre communauté.
Un tel dialogue de la foi n'est possible qu'entre
des hommes
et des femmes pour qui leur propre foi n'est pas de
l'ordre
d'une réponse mais de l'ordre d'une question.
Il n'est possible que si chacun a conscience que, si
Dieu est
transcendant, sans commune mesure avec nos
pensées et nos
langages, aucun homme ou aucune communauté ne peut
avoir
la prétention de l'enfermer dans ses définitions,
ses rites et ses
dogmes. Une telle « suffisance » est le contraire de
la « transcendance».
Ce dépassement de toutes les « idées », de toutes
les « images
» que les peuples peuvent se faire de Dieu, se
manifeste par
ceci : en toutes les religions révélées Dieu parle
aux hommes par
paraboles, utilisant des expériences humaines pour
suggérer ce
qui transcende toute expérience et tout concept, et
la foi de
ceux qui ont le plus profondément vécu la présence
divine,
reconnaît que l'on peut seulement, dans une
théologie négative,
dire ce que Dieu n'est pas. Ils n'ont parlé de Dieu
que
par métaphore ne pouvant le saisir mais seulement le
désigner
par une parole humaine, celle du poème, qui ne
prétend pas,
comme le concept, cerner le réel dans une définition
et en donner
le contenu : Ibn Arabi comme saint Jean de la Croix,
Rabi'a
de Bassorah comme sainte Thérèse d'Avila, ont essayé
de traduire,
par le poème et ses symboles, une expérience qui ne
peut
s'exprimer par des concepts.
Cette conscience humble de ce qui manque et manquera
toujours
à notre foi pour étreindre le divin, est la
condition première
du dialogue de la foi.
Ce dialogue commence en nous-mêmes. En nous-mêmes,
divisés entre le doute et la foi : le doute
nécessaire pour maintenir
une foi vivante, c'est-à-dire conscience de ses
limites, de
son impuissance à égaler l'absolu.
« Tout ce que je dis de Dieu, c'est un homme qui le
dit »,
écrivait Karl Barth. Un homme avec ses insuffisances
et sa relativité.
Même si Dieu parle, c'est un homme qui écoute la
révélation,
qui l'interprète, qui la réduit à ses propres
dimensions
humaines, dans son langage adapté à la saisie des
choses, du
partiel, que la transcendance déborde.
Un dialogue de la foi, un dialogue véritable n'est
possible
qu'à partir de la conscience de ce qui nous manque.
De ce qui
manque à notre foi pour atteindre à la plénitude à
laquelle elle
aspire. Ce qui manque à notre finitude d'homme pour
accéder
à l'infini, ce qui manque à nos communautés
partielles
pour atteindre le tout.
Alors seulement, à partir de cet aveu de ce qui me
manque,
le dialogue peut devenir un échange et un partage
dans la
recherche commune, dans les approches
complémentaires de
Dieu, c'est-à-dire du sens dernier de nos vies
personnelles et
de notre commune histoire.
La réalité totale ne peut être saisie à partir d'une
perspective
seulement. Nous ne pouvons la saisir pleinement que
si
nous savons vivre du dedans l'expérience des autres.
Plusieurs peintres s'efforcent de dessiner le même
modèle,
placé au milieu d'eux, mais aucun tableau ne sera
identique
à l'autre. L'un aura reproduit le sujet de face, un
autre de dos
ou de profil. Je ne puis juger de la fidélité de
l'image à partir
d'une perspective unique, mais seulement à partir de
la perspective
propre à chaque participant.
Il en est de même pour les sagesses et les religions
: chacun
a essayé de traduire son expérience du sens de la
vie ou de l'Un
en fonction d'une culture particulière, d'une
histoire et d'une
civilisation. Cette multiplicité et cette relativité
des « prises de
vue » sur le divin n'exclut nullement la valeur
absolue et unique
de ce qui est visé et dont l'inépuisable totalité ne
peut être
saisie par personne.
Un dialogue ne peut conduire à une fécondation
réciproque
que si chacun accepte loyalement de « se mettre à la
place » de
l'autre, donc à retrouver son angle de vue, la
perspective propre
à partir de laquelle il a essayé d'exprimer son
irremplaçable
expérience.
Ceci exclut le parti pris de conversion : ne pas
demander au
chrétien de devenir bouddhiste, ni au musulman de
devenir
chrétien. Mais aider le bouddhiste à devenir un
meilleur boud-
dhiste, le chrétien un meilleur chrétien, le
musulman un meilleur
musulman. « Meilleur » signifiant : capable
d'approfondir
sa propre foi, sa propre saisie de Dieu, en
l'enrichissant de
l'expérience des autres hommes de foi.
Cette prise de conscience de la relativité, de la «
nonsuffisance»
des perspectives, n'implique nullement, répétonsle,
des perspectives, n'implique nullement, répétonsle,
un relativisme ou un éclectisme démobilisateur. Elle
rappelle
seulement la diversité et les richesses inépuisables
des relations
à Dieu. Elle permet seulement d'échapper à
l'ethnocentrisme
colonialiste qui appelle trop facilement «
universelle » sa propre
culture et sa propre religion.
Dans le dialogue l'éclectisme ou le syncrétisme,
c'est-à-dire
la recherche du plus petit commun dénominateur, ne
peut
conduire qu'à un appauvrissement de la foi. Si nous
écartons
ce qui est spécifique en chacun pour ne retenir que
ce qui peut
se dire avec les mêmes mots, il n'y aura pas
d'enrichissement
ni de fécondation réciproque.
Contre cette conception réductionniste, abstraite et
desséchante
du dialogue, ce qu'il s'agit de partager c'est
l'approche
du Dieu vivant à travers la richesse des expériences
de la
vie en Dieu propres à chaque culture.
Ceci implique de notre part une manière de vivre
Dieu et
une autre façon de parler de Dieu (une autre «
théo-logie »).
Comme toute saisie partielle de Dieu, le limitant à
tel ou
tel « signe » de sa présence, c'est une idolâtrie de
le réduire aux
images qu'en ont donné notre seule culture, notre
seule
histoire.
Dieu n'est pas seulement ce qu'en dit notre seule
tradition
judéo-grecque. Il est le Dieu de toute l'histoire,
le ferment de
l'histoire de tous les continents, l'âme de tous les
efforts des
hommes — de tous les hommes — pour découvrir et
réaliser
le sens de leur vie. Seule cette universalité, cette
véritable universalité,
cette ouverture vers l'autre, cette écoute de
l'autre,
peuvent rendre possible la révélation du Dieu qui
est en Lui.
Car c'est en l'autre aussi que nous découvrons Dieu.
Pas seulement
en nous, dans la langue de notre culture partielle.
Dieu,
le même Dieu, le seul Dieu, a été vécu à partir
d'autres expériences
qui doivent cesser de nous être étrangères. Le
dialogue
devient alors la merveilleuse aventure de la
recherche commune
de Dieu. Il n'a pas pour objet de convertir,
c'est-à-dire de
réduire l'autre à nous-mêmes, mais de nous ouvrir à
d'autres
rencontres de Dieu en partageant l'expérience de
l'autre.
L'attitude « polémique » des religions (et le mot de
« polémique
», par son étymologie, évoque la guerre : polémos)
a été
l'une des forces les plus destructrices de
l'histoire, avec ses croisades,
ses « guerres saintes », ses inquisitions, ses
mythologies
de « peuples élus ».
Alors que l'esprit de rencontre, d'écoute
fraternelle, et de
fécondation réciproque est la force la plus
humanisante de
l'histoire.
Chercher Dieu en l'autre, y découvrir la présence
plurielle
du même Dieu, est une manifestation de l'amour.
Comme
l'amour elle est inconditionnelle : elle ne dépend
pas de la réciprocité,
même si elle se heurte au fanatisme, ou, pire
encore,
à l'indifférence.
Contre les idolâtries conjointes du monothéisme du
marché,
de la technocratie, de l'argent, répandues
aujourd'hui à
l'échelle de la terre, le monde a plus que jamais
besoin de
témoins vivants du Dieu vivant comme levain de la
lutte pour
libérer l'homme de ces idolâtries et de leurs
servitudes.
Le mot même d'« évangélisation » signifie : «
l'annonce
d'une bonne nouvelle », celle du triomphe de la vie
sur la mort,
du sens sur le non-sens, que les chrétiens et les
musulmans
appellent la résurrection : celle de la promesse,
pour chaque être
humain et pour chaque communauté, de la libération
et de la
plénitude de son développement que les chrétiens et
les musulmans
appellent le Royaume de Dieu.
Nous avons donc à nous « évangéliser les uns les
autres ». Il
ne s'agit plus de l'exportation unilatérale d'un credo,
mais
d'une rencontre avec le divin, plus riche par le
partage et la
fécondation mutuelle des cultures de tous les
continents et de
leurs expériences du divin. Ainsi éclateront les
limites d'une
culture occidentale qui, depuis la Renaissance
repose sur trois
postulats :
— Le postulat de Descartes: « Nous rendre maîtres et
possesseurs
de la nature », une nature réduite à son aspect
mécanique.
Donc des rapports de domination sur une nature
dépouillée de toute finalité propre.
— Le postulat de Hobbes, définissant les rapports entre
les
hommes : « L'homme est un loup pour l'homme. » Des
rapports
de concurrence sur le marché, d'affrontements de
jungle
entre les individus et les groupes, des rapports,
aussi, de maître
à esclave. Et, au niveau actuel de nos pouvoirs
techniques,
des « équilibres de la terreur ».
— Le postulat de Marlowe, dans son Faust, annonçant
déjà
la mort de Dieu : « Homme, par ton cerveau puissant
deviens
un Dieu, le maître et le seigneur de tous les éléments.
» L'atrophie
de la dimension transcendante de l'homme et le refus
de
toute valeur absolue sont ainsi consacrés.
Cinq siècles d'expérience ont montré que les
postulats d'une
telle culture conduisent le monde à la mort.
— La « maîtrise » de la nature conduit à son
saccage, par les
armes de destruction massive, par l'épuisement des
ressources
accumulées dans les entrailles de la terre depuis
des millions
d'années, par la pollution industrielle menaçant
jusqu'à l'ozone
qui nous protège de la mort.
— La concurrence entre les hommes sur un marché
mondial
sans limite a conduit aux guerres les plus
meurtrières de tous
les temps, à l'explosion des nationalismes les plus
agressifs, aux
« fondamentalismes » les plus bornés et surtout à
des inégalités
telles que le dernier postulat de cette civilisation
selon
laquelle l'homme doit remplacer Dieu, en faisant
abstraction
de sa dimension transcendante, est le fondement des
deux
autres.
Tant que le « progrès » sera défini par le seul
perfectionnement
des outils et des machines,
tant que la liberté de l'homme sera confondue avec
la liberté
du marché,
tant que Dieu sera ou nié ou identifié à un maître
toutpuissant
dirigeant le monde selon un plan éternel, extérieur
et
supérieur à l'homme, fondement de toute théologie de
la
domination, faisant ainsi de la religion un « opium
du peuple»,
les dérives du système précipiteront un suicide planétaire.
les dérives du système précipiteront un suicide planétaire.
D'autres civilisations et d'autres cultures ont
conçu et vécu
d'autres rapports avec la nature, les autres hommes
et Dieu.
— Dans la perspective du Tao la nature n'appartient
pas à
l'homme. L'homme appartient à la nature. Dans le
Coran, la
nature n'est pas un matériel inerte voué à
satisfaire la volonté
de puissance des hommes mais un ensemble de « signes
», un
langage que Dieu nous parle comme dans les
révélations des
livres sacrés.
De saint François d'Assise à Teilhard de Chardin
terre et
matière, vie végétale et vie animale entrent dans un
dialogue
fervent entre l'homme de foi et une nature inséminée
de divin.
— Les rapports entre les hommes ne se sont pas toujours
réduits à l'individualisme de jungle caractéristique
du monothéisme
du marché, c'est-à-dire de l'argent.
De l'Afrique à l'Amérindie et de l'Inde à la oumma
musulmane,
ont été vécues, avant les grandes invasions de
l'Occident,
de véritables « communautés » c'est-à-dire des
ensembles
humains dans lesquels chaque membre se sent
personnellement
responsable de tous les autres, de la « communauté
de base »
à la « communion des saints ».
— Les rapports avec le divin, avec la transcendance des fins
dernières, ont été aussi vécus sous d'autres formes
que l'oubli
des fins et du sens, ou de la soumission à
l'extériorité d'un destin
voulu par Dieu. Du Popol Vuh des Indiens d'Amérique
aux
Védas et à la Bhagavad-Gita, ils ont été vécus sous
la forme de
plus en plus intériorisée du sacrifice et de
l'action conçue
comme la participation humaine à la réalisation de
l'Un et du
Tout, par la lutte entre le partiel et
l'égocentrisme.
Le tawhid des musulmans ordonne toute pensée
et toute
action en fonction de l'universalité du Tout. Elle
exclut la particularité
des nationalismes comme la dualité fondée sur
l'accumulation
de la richesse et du pouvoir à un pôle de la
société.
Cette unité ne contredit nullement la vision
chrétienne de
la Trinité, dont le mystique musulman Ruzbehan de
Shiraz,
au XIP siècle,
donnait cette formulation qui évite les confusions
du langage grec : « Dieu est l'unité de l'amour, de
l'amant et
de l'aimé. »
La prise de conscience de cette nécessaire
complémentarité
des hommes de foi dans la recherche commune de ce
qu'il y
a de plus profond dans leur propre foi, permet de
rendre à
l'homme toutes ses dimensions : cosmique, comme
partie de
la nature, humaine par la conscience d'être habité
par l'humanité
entière dans la totalité de son histoire, divine par
sa
participation responsable à la construction d'un
avenir à visage
humain, c'est-à-dire divin1.
Ainsi seulement peuvent être combattus
victorieusement, par
l'union de tous les hommes de foi, les fléaux
mortels de notre
temps : le positivisme, qui en enfermant la pensée
dans un
monde de données et de nécessités, enferme l'homme
dans le
désordre établi, et l'individualisme né du
monothéisme du
marché et de son corollaire : l'oecuménisme de la
jungle.
Roger Garaudy
Avons-nous besoin
de Dieu ?
DDB-Introduction de l’Abbé Pierre
1993
Pages 145 à 161
DDB-Introduction de l’Abbé Pierre
1993
Pages 145 à 161