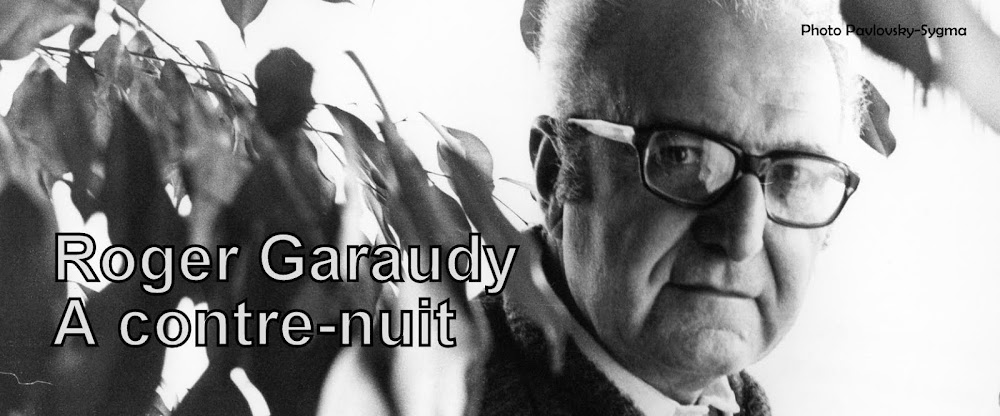43. Le « prieur » de Vianden (p.123-125)
Clervaux, au Grand-Duché de Luxembourg. Me voici une fois encore dans un monastère bénédictin : Maredsous, Oosterhout, Ligugé, La Pierre-qui-vire, Belloc, En-Calcat, La Rochette…Est-ce la nostalgie de n’avoir pas été jusqu’au bout de l’appel de Dieu ? Dans sa règle, saint Benoît n’envisage l’existence du moine que dans les limites de la clôture. Il n’est jamais question d’activités extérieures. Le moine vit pour Dieu et pour Dieu seul. Il n’a besoin que de silence et d’éloignement. C’est un radicalisme qui va beaucoup plus loin que le « Dieu premier servi » de ma vocation.
Je me demande, d’ailleurs, si j’aurais pu supporter longtemps ce genre de vie. Pendant quelque temps, c’est une bénédiction, loin du téléphone et du harcèlement quotidien. La prière chorale vous emporte sous les voûtes majestueuses de l’édifice et vous donne comme un avant-goût du ciel. Mais…je ne m’y vois pas très bien, pendant une vie entière.
Autre chose m’attire vers les monastères. Je m’y sens en communion avec tout ce qui y vit ou y a vécu. Je découvre avec émotion, au cimetière des moines, la tombe de Louis Baillet (1875-1913) qui fut, à Sainte-Barbe, un des plus proches amis de Péguy. « Pendant ces persécutions stupides, injustes, lui écrivait Péguy, je veux te renouveler l’assurance d’une amitié qui demeure entière. Vous, catholiques, réjouissez-vous : les persécutions des radicaux préparent incontestablement une renaissance de la foi catholique en France. » C’était le 26 juillet 1902. Péguy, alors encore incroyant, avait pris position contre la loi Combes, au nom de la liberté. A Clervaux, je retrouve Claudel qui y est passé plus d’une fois et je mets mes pas dans ceux de Victor Hugo. Certes, je sais bien que l’abbaye Saint-Maurice et Saint-Maur de Clervaux n’existait pas encore au temps du poète, mais celui-ci a parcouru la région et il a lié à jamais son nom au paysage romantique de l’étroite et sauvage vallée de l’Our.
Je me trouvais à sa place, cet après-midi, dans cette « maison du coin du pont » qu’il avait choisie à Vianden et d’où il avait une vue sinistre sur les ruines du glorieux château. Je le vois, rageusement, en train de composer L’Année terrible ou de jeter sur le papier les silhouettes torturées de la montagne. « Aujourd’hui, dans son paysage spendide que viendra visiter un jour toute l’Europe, Vianden se compose de deux choses également consolantes et magnifiques, l’une sinistre, une ruine, l’autre, riante, un peuple. » Victor Hugo, 8 juin 1871 !
Il y une religion « Victor Hugo » qui fait de lui un personnage si attachant, un siècle après sa mort. A Vianden, de son vivant, il n’en fut pas toujours ainsi. Le 23 juillet 1871, du haut de la chaire de vérité, le curé de Vianden s’élevait « contre les trois religions du diable : le luthéranisme, le calvinisme et le hugolisme ». Je préfère me fier à Henri Guillemin qui se tient au courant de tout et puise ses informations, en remontant sans préjugé, aux sources des inédits. J’aime Victor Hugo, l’immense poète, mais plus encore l’homme engagé. Dans son Journal (voir Témoignage chrétien, 19 février 1955), Adèle Hugo rapporte quelques propos tenus par son père, à Jersey : « Demain, s’il fallait que toute la littérature soit détruite et qu’à mon choix, il ne me restât plus qu’un seul ouvrage, je garderais Job…Ceux qui ont dit que je faisais de l’art pour l’art ont dit une chose inepte. Personne plus que moi n’a fait de l’art pour la société et l’humanité. »
Victor Hugo a été foncièrement un « prieur » (le mot est de lui), dans le sens de quelqu’un qui « prie » et qui croit profondément en Dieu, rejetant tout ce qui, sur cette terre, risque de Le dénaturer. Prophète et visionnaire, il voyait souvent les choses en opposition avec les idées de son temps. Il était résolument contre la peine de mort qui était d’application courante. Il rêvait d’une Europe unie alors que les nationalismes triomphaient. Marqué par le livre de Blanqui La Condition des classes ouvrières en France, en 1848 et par une enquête personnelle dans les « caves » de Lille (sur 21000 enfants d’ouvriers, nés en 1840, trois cents seulement survivaient en 1848), Victor Hugo avait compris la portée réelle des journées tragiques de juin 1848. « Si la pauvreté est inévitable, la misère doit être intolérable. » Il savait ce qu’étaient Les Misérables (conçus dès 1845). Il mesurait maintenant les causes sociales de la misère et les responsabilités du désordre établi. Il intervint vigoureusement, dans son discours du 9 juillet 1849, rompant avec son parti (« Etre de cette majorité, préférer la consigne à la conscience ? Non ! »), parce que celui-ci ne voulait rien faire pour améliorer la condition des prolétaires. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la préface philosophique des Misérables (« Pas de fraternité humaine sans paternité divine ») et son attitude, les 2 et 3 décembre 1851, à l’égard de Napoléon le Petit, quand il paiera de sa personne. « Qui assiste muet au crime assiste le crime. »
Sait-on qu’une Carmélite de Tulle a beaucoup occupé la pensée de Victor Hugo, dans ses dernières années ? Il s’agit de Marie Hugo, la fille du général Louis Hugo, l’homme du « cimetière d’Eylau », oncle du poète. Je ne puis résister au désir de retranscrire une des lettres du vieillard à la jeune Carmélite, datée du 25 juin 1870 :
« Bonjour, chère Marie. Ta lettre m’émeut. Oui, prie pour moi. Je suis de ceux qui croient à la vertu de la prière. Ta prière doit être bonne puisque ton âme l’est.
Il n’y a qu’un Dieu. Le tien, par conséquent, est le même que le mien. Nous le servons chacun à notre manière, toi en priant, moi en luttant. Je suis vieux et je Le verrai bientôt. J’espère qu’Il me pardonnera mes fautes et qu’Il me tiendra compte de ma bonne volonté. Si je me trompe, c’est avec sa permission ; mais il est certain que je n’ai jamais fait, ni voulu faire, du mal qu’au Mal. Je me rends cette justice et j’espère.
Aime-moi toujours et sois heureuse… »
44. A l’hôtel du Mal Aimé (p.127-128)
Le hasard fait bien les choses. Mais le hasard existe-t-il ? En me rendant à Stavelot, l’autre jour, pour présider un tournoi d’éloquence, je ne savais pas où je logerais, ni même si je logerais. Pas de place au Prince d’Orange, ni au Val d’Amblève. Je fus, pour mon plus grand bonheur, littéralement dirigé vers l’Hôtel du Mal Aimé, rue Neuve, où un jour de 1899, Guillaume Apollinaire cueillit, sur les lèvres d’une paysanne de chez nous, la seule expression walllonne qui ait fait le tour du monde littéraire : « Que vlo-ve ? »( Que voulez-vous ?). L’hôtelier, spontanément, m’offrit la chambre du Mal Aimé. Aux murs, quelques strophes, écrites à Stavelot, et le portrait de Marie Dubois, dite « Mareye ». Ajouterai-je que, réveillé par mes muses, je n’ai guère dormi cette nuit-là ?
Dans cette chambre où je la vois
Entre les murs où je l’écoute
Pensant à l’autre avec émoi
Perçant l’abcès que je redoute
J’ouvre les mains seul et sans voix
Je sais trop bien que mon cœur saigne
De sentir le poids du péché
Que cette odeur dont je m’imprègne
En cet hôtel du Mal Aimé
Rejoigne Dieu pour qu’Il m’étreigne
Je regardais par la fenêtre
Tomber le soir et la tiédeur
Sur cette ville où tous les êtres
Ignorent tout de ma douleur
O sœur ne laissons rien paraître
On l’appelait Marie Dubois
Dans ce coin qui n’a pas changé
L’hiver, l’Amblève et les grands bois
Fallait-il être Mal Aimé
Pour fuir à la cloche de bois
Que vlo-ve en cette rude terre
C’était Guillaume Apollinaire
45. Mon Paris, c’est ma langue (p.129-131)
« J’ai toujours été fier de Paris parce que Paris est ma ville natale » écrit l’Américain Julien Green dans un livre attachant qu’il vient de consacrer à sa ville. Moi aussi j’éprouve le sentiment d’être né à Paris parce que la langue française est ma patrie et que la langue française est née à Paris.
« A peine arrivé, le voyageur sent l’étreinte de cette ville qui est bien plus qu’une ville » déclare un autre Américain, John Steinbeck. Je me suis souvent demandé ce que ressentaient les étrangers à la découverte de Paris. De l’admiration sûrement, de l’étonnement peut-être, de la fascination quelquefois ! Bien sûr, mais pour moi, tout cela vient après ou en plus. J’aime Paris parce que je m’y sens chez moi, dans le berceau de mon langage. Cette langue que je savoure dans les théâtres, que je déguste dans les bistrots, que j’entends jaillir de source, dans la bouche des enfants, c’est la mienne, c’est la nôtre, celle que tout le monde parle dans mon village de Wallonie et que j’ai appris à balbutier sur les genoux de ma mère. Elle me vient des bords de la Seine.
Est-ce possible, Seigneur ? Je n’aurai jamais assez de jours pour vous remercier d’une telle aubaine. Ce que je vais dire n’est pas raisonnable ; cependant, cela n’a rien d’offensant pour les autres peuples. Il m’arrive de frémir à la pensée que j’aurais pu naître Américain, Russe ou autre chose et d’être ainsi privé de cette source permanente qui plonge au plus profond de mon être et qui me fait vivre et respirer.
J’écris du septième étage d’un petit hôtel vietnamien du boulevard Saint-Germain et j’ai devant moi, à quelques dizaines de mètres, les tours de Notre-Dame. Je suis parti ce matin, le livre de Julien Green sous le bras, pour perdre un peu de temps, marcher beaucoup et faire halte aux lieux qui me sont familiers depuis si longtemps : une eucharistie à Saint-Sulpice, une prière à la chapelle de la Médaille miraculeuse, deux heures au musée Rodin où ressuscite en ce moment l’incroyable destinée de Camille Claudel, un coup de chapeau à Notre-Dame pour terminer dans le silence de Saint-Julien-le-Pauvre où les grandes ombres de Dante et de Thomas d’Aquin ne cessent jamais de me poursuivre et de m’illuminer. En cours de route (ce que je ne ferais jamais chez nous), je m’arrête dans telle ou telle brasserie du coin, et j’écoute, et je regarde, et je lis. Les souvenirs ressurgissent. Les pierres me parlent. Les arbres ont un charme que je ne leur connais nulle part. La Seine vient constamment à ma rencontre. Le ciel de Paris, quel qu’il soit, celui de mars, en ce moment, avec sa lumière resplendissante, m’inspire des états d’âme que je ne puis décrire.
Mais revenons à la raison. Pendant des années, j’ai piloté des dizaines et des dizaines de jeunes à travers Paris. Je leur ai fait découvrir, pas à pas, les trésors de l’île de la Cité. Je leur ai montré le Paris traditionnel, des Invalides au Panthéon, et le Paris des temps futurs qui commence au carrefour de la Défense. Je les ai amenés sur la Seine et sur la butte Montmartre. Nous avons vécu des heures captivantes : 1789 à la Cartoucherie de Vincennes, de Gaulle sous l’Arc de Triomphe et mai 68 au Quartier latin.
Mais qu’est-ce que tout cela au regard du Paris invisible, celui dont parle Julien Green et qui ne peut être révélé aux touristes ! Ville qui fut l’assise de la pensée européenne où enseignèrent Thomas d’Aquin, Albert le Grand et Ignace de Loyola. Ville qui reste le champ de manœuvres de la pensée mondiale, siège de l’Unesco. Ville où se sont accomplies les trois révolutions de l’homme moderne : la Révolution française à la Bastille , la révolution cubiste à Montmartre et au LapinAgile, la révolution nègre, au Quartier latin, avec Senghor et Césaire.
Pour ma part, je garde un souvenir ému, inoubliable, de mon premier séjour à Paris, au sortir de la guerre et de la tourmente lorsque je voulus, avant toutes choses, m’arrêter et me recueillir, avec Péguy, devant la boutique des Cahiers de la Quinzaine.
Paris, nous confie Raïssa Maritain, née Oumançoff, en Russie : « Ville impérissable et puissante par les œuvres dont elle a enrichi la terre, par les saints dont elle a peuplé le ciel…Ville de grand péché – mais qui est sans péché ?...Ville où le bien a le pas sur le mal et la vérité sur l’erreur, capitale de la liberté. »
J. BOLY, Le journal d’un mutant de l’île de Gorée, Bruxelles, CEC, 1987
J. BOLY, Le journal d’un mutant de l’île de Gorée, Bruxelles, CEC, 1987